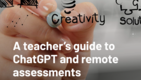Dans l’univers du numérique, les mots s’émancipent de tous les carcans. Le Web a forcé les frontières. Internet s’est immiscé dans toutes les cabosses. Qui voudrait substituer « gratuiciel » à « freeware » se heurterait à l’indifférence dédaigneuse de l’usage. Une autorité voudrait refréner la popularité de l’anglicisme « fake news » que l’expression s’est déjà dispersée tous azimuts. « Les mots sont d’infatigables globe-trotteurs. Ils se jouent des fouilles et des censures. Les mots sont libres comme l’air », écrivait Bernard Pivot. Pourtant, ils ont quelquefois bataillé pour coloniser nos palais.
En 1955, « ordinateur » a triomphé de ses duels successifs. Aujourd’hui, dans un Occident davantage mûr pour honorer la part féminine de nos mystérieuses machines, gageons qu’ordinatrice l’emporterait. En 1955, « congesteur » et « digesteur » déclarèrent forfait sans grogner, tandis que « systémateur », « calculateur » ou « combinateur ». résistèrent fièrement. Si l’ordinateur s’imposa, ce ne fut sans combattre.
« Dieu qui met de l’ordre dans le monde » : l’origine du mot en préfigure le destin. Exaucé par nos frénétiques routines, l’Ordinateur est déifié par nos offices numériques permanents. Nos corps raidis, dans l’attitude de la prière, quelquefois jusqu’au sacrifice de soi, souffrent de la conversion de nos esprits au Royaume du Binaire.
Exemptes d’esprit de réforme, ces lignes proposent un rapide éclairage sur quelques mots d’usage quotidien :
- I(i)nternet : le réseau informatique mondial constitué d’une multitude de réseaux locaux. Avec une majuscule, Internet désigne une réalité unique, tout comme « la Suisse » ou « UniDistance », l’hégémonie en plus. La minuscule autoriserait les alternatives : d’autres internets sont possibles, voire désirables. On écrit bien « télévision » ou « téléphone », pourquoi pas « internet » ? [1]
- Web : le réseau d'informations qui utilise le réseau physique internet. Ce sont les milliards de documents connectés sur d’indénombrables serveurs. Internet est le réseau physique, le Web est le service qui permet les communications intersidérales.
- Google : le célèbre moteur de recherche tire son nom d’une unité de grandeur, le « gogol », c’est-à-dire 1 suivi de 100 zéros. Pensons à un « Googler », entendez un employé de Google, manipulant des milliards et des milliards de données.
- Bulle de filtres : la notion renvoie à la tendance des algorithmes de trier et sélectionner des contenus qui correspondent aux attentes et au goût de chaque utilisateur. « Il s’agit d’un espace virtuel dans lequel les opinions ne font que se conforter car il n’y a plus d’influences contraires » (Ionos, 2020).
Et ainsi de suite, les mots de la nébuleuse multimédia ont des origines alambiquées. L’antique focus conserve de pérennes perspectives. D’origine exotique, le wiki s’accommode à tous les pays. La centralisante carte-mère nous rappelle à nos origines. Mais la langue est aussi une question d’épiderme. Les francophones préfèrent « logique », « virtuel », « électronique », « informatique » ou « numérique » à « digital » qui règne, monarque omnipotent, chez les anglophones [2]. Car c’est bel et bien de pouvoir dont il s’agit. « Une langue n’existe pas, elle peut. Cette puissance veut dire simplement le pouvoir de dire tout. Cette langue-là, qui dit tout, cette puissance de dire tout, le dit d’un point de vue unique, particulier, original, authentique et irremplaçable », exprimait Michel Serres.
Pourtant, beaucoup de mots s’engourdissent. Sacrifiés sur l’autel de l’efficacité, ils risquent l’asthénie. Songeons aux milliers de courriels desséchés déversés dans nos boites aux lettres via des câbles multifilaires. Par pop-up, ils surgissent sur nos écrans, avides d’un éclat d’attention, balayés d'un clic. Ne semblent-ils pas toujours plus brefs, truffés d’émoticônes et, à peine lus, frappés d’obsolescence ? Combien de mots s’amuïssent-ils [3] ? Via le net, un mail ne file-t-il par en 4 sec. ?
Notes :
[1] Le consensus n’existe pas à ce sujet. Le New York Times préférera «Internet» avec une majuscule, tandis que l'Organisation des Nations Unies utilisera « internet » avec une minuscule. Sous forme d’adjectif, on préférera toujours la minuscule.
[2] Exemples : « digital signal » devient « signal logique » ; « digital data » se traduit par « donnée informatique » ; « digital pet » se mue en « animal de compagnie virtuel » ; « digital currency » se convertit en « monnaie électronique », etc.
[3] S’amuïr : s'effacer de la prononciation, en parlant d'un son. Le [s] s'est amuï dans "bête" qui remplaça "beste".